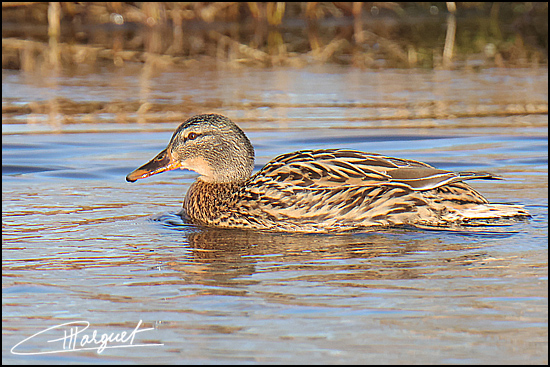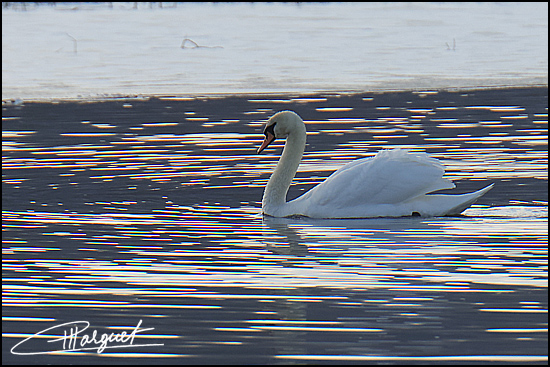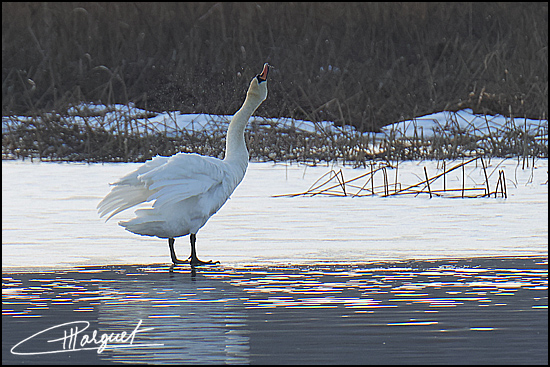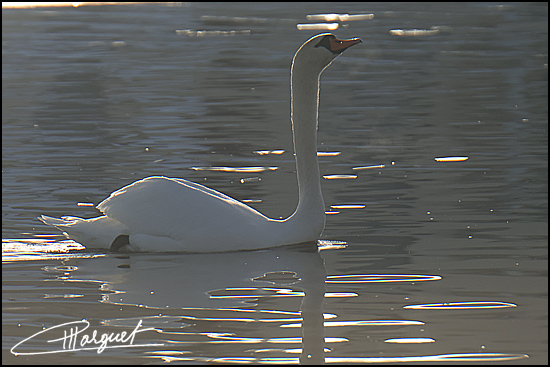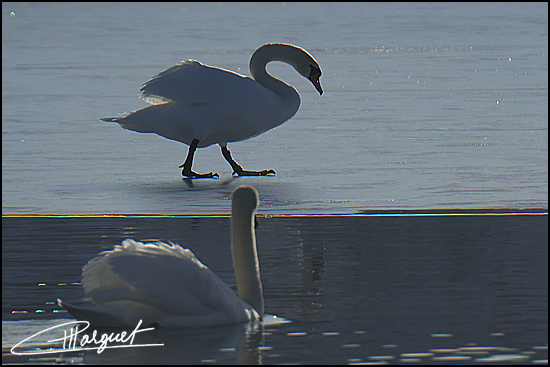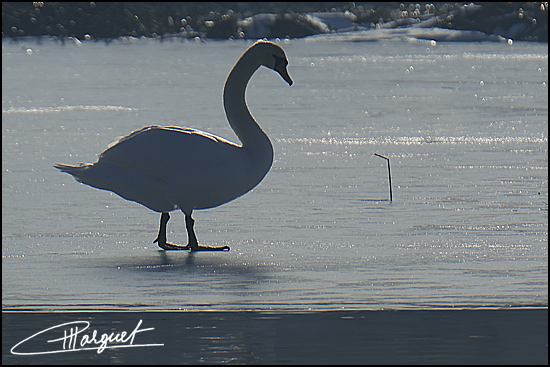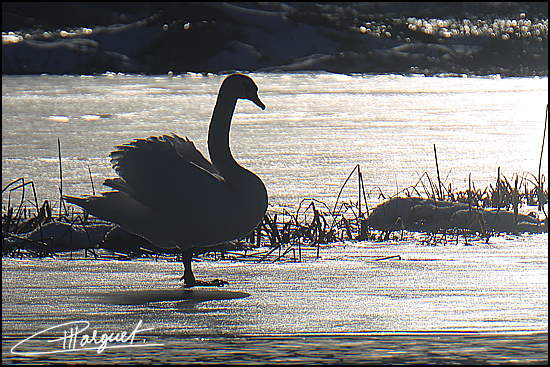Suggestion de lecture :
"1
Saigner
Le chaton sommeillait,
minuscule et tiède, dans une paume colossale. C’était
celle de Louis, jardinier puissant et taiseux, dont le
poids faisait craquer le cannage d’une chaise. Il se
tenait assis à l’étage d’une humble maison en pierre. Son
visage, inquiet, semblait près de se défaire. Du pouce, il
effleurait un point, juste au creux de la gorge de la
bête. Un point infime, qui pourtant occupait tout son
esprit.
Louis veillait ainsi
l’innocente boule de poils enroulée sur elle-même.
Rêvait-elle ? À quoi donc pouvaient ressembler les
songes d’un être si récemment venu au monde ? Tandis
que cette pensée le traversait, il regardait par la
fenêtre le balancement des grands arbres centenaires. La
tempête s’intensifiait, tordait l’air, brisait les rameaux
des oliviers. Mais le chaton, indifférent au vacarme,
ronronnait. Dehors, les vrombissements anarchiques de
l’orage ; dedans, le murmure régulier, apaisant, de
l’animal…
Où avait-il appris que la
fréquence de ce son oscillait entre 26 et
44 hertz ? Il ne s’en souvenait plus. Peut-être
l’avait-il inventé. Mais il en était certain : le
ronronnement est un signe plus ambivalent qu’il n’y
paraît. Si le corps d’un chat vibre ainsi, de
façon presque tellurique, ce n’est pas seulement pour
manifester une joie pleine et entière, c’est aussi pour
lutter. Ce souffle feutré soigne les blessures, guérit les
maux, répare les os, les tissus, le sang. Louis caressait
le pelage gris et blanc. Il aurait pu continuer sans fin.
Le ciel convulsait à
présent, et emportait dans sa furie les paysages du Midi.
Les pins penchaient, ployaient, sifflaient. Ils périraient
peut-être. À chaque branche brisée, ils criaient leur peur
de tomber à jamais. Le vent accélérait encore, ivre de sa
propre vitesse. Toute la campagne priait en secret pour
que cesse cette frénésie insensée de l’air et de la pluie
qui, sous l’effet des bourrasques, tombait à l’oblique. Et
ce n’étaient ni les lances du mistral ni les colères
familières de l’orage ou de la foudre, si fréquentes sur
les côtes méditerranéennes, qui faisaient ce soir-là
claquer les volets et sursauter les enfants, mais un
tumulte d’une violence inconnue, presque surnaturelle.
Louis observait, inquiet,
la saignée qui entamait les prairies et les champs. Dans
la demeure voisine, il perçut un descellement de pierres
sèches. La déflagration se confondit avec le désarroi qui
l’habitait depuis le matin, comme si les éléments, dans
leur déchaînement, donnaient corps à sa colère mêlée de
chagrin.
Cette rage avait pour
cause une funeste nouvelle. Le chaton était condamné à
court terme – il mourrait prématurément, sans espoir
possible, lui avait-on dit. Une dizaine de jours
auparavant, l’homme avait noté que son compagnon lapait
son lait avec moins d’appétit. L’animal se montrait
contrarié au moment de plonger le museau dans sa coupelle.
Louis l’avait alors conduit chez une vétérinaire
fraîchement sortie de l’université et installée dans une
ville voisine. Après une série d’examens, elle avait eu
les mots fatals. Sous la douceur des poils s’était nichée
une vilaine tumeur, au niveau de l’œsophage. Il n’y avait
rien à faire. La jeune femme avait suggéré
l’impossible : envisager une euthanasie, pour
épargner à la bête les souffrances à venir.
Louis n’avait rien
répondu. Il n’avait pas posé de questions ni dit « au
revoir ».
Il s’était contenté de
reprendre le chaton contre lui et, instinctivement, de
tourner son pouce là où le mal avait mystérieusement
germé, espérant ainsi dissiper le cancer naissant. Puis il
était revenu chez lui, meurtri. Alors, le vent avait
commencé à se lever. Au début, il ne s’agissait que de
souffles épars et tourbillonnants, mais à mesure que
l’heure avançait, ils se changèrent en tornades. Les
nuages, eux, restaient agglutinés, figés dans le ciel,
prêts à déverser leurs trombes sans jamais s’arrêter.
*
Louis était de cette
espèce d’individus qu’on qualifie de sensibles. Et même,
selon un vocabulaire que la psychologie a fini par imposer
dans le langage courant, il était ce qu’on nomme un
« hypersensible ». Ce trait constitutif, voire
central, de sa personnalité s’avérait d’autant plus
déroutant que sa carrure de colosse lui conférait, en
surface au moins, l’image d’une force invincible, presque
métallique. Mais la bonté de son cœur avait transformé
celui-ci en un organe tendre et friable comme l’argile.
Naît-on « hypersensible » ? Ou le
devient-on à la faveur des événements, notamment ceux de
l’enfance ? Difficile à dire. Chez Louis, les
premiers signes de cette extrême porosité à son entourage
étaient apparus dès son plus jeune âge, au contact de la
faune et de la flore. Fils unique de modestes bergers de
Provence, il avait tôt ressenti une affection
indéfinissable pour l’écorce des arbres et le pelage des
bêtes – une tendresse si vive qu’elle avait
éveillé en lui une empathie magnétique, propice aux
sourires et aux larmes. Aussitôt jeté dans l’existence, il
aima les moutons et les chiens de troupeau, bien sûr. Mais
surtout les chats. Et pourquoi donc ? Parce que, dans
une bergerie, un tel animal ne servait à rien, disait-on…
S’il était là, c’était à titre de compagnon, ce qui ne
pesait pas lourd dans le nécessaire labeur du quotidien.
Cette prétendue inutilité avait jadis touché le petit
Louis au plus haut point, le renvoyant peut-être à sa
propre sensation d’insignifiance et de vulnérabilité.
La Provence est sujette
aux incendies – c’est son drame, son supplice de feu.
Louis y avait assisté, terrifié et prostré, dès l’enfance.
Souvent, des animaux fuyant les flammes et la fumée
venaient se réfugier à la bergerie. Dans l’indicible
douleur de voir périr les grands pins et les vignes, il
trouvait pourtant une forme de joie : celle
d’accueillir – il préférait ce mot à
recueillir – et de sauver des bêtes, parmi lesquelles
ses compagnons félins. À l’époque, alors que sa main était
encore trop menue pour servir de berceau, il leur offrait
ses souliers vides en guise d’abris. Les chatons s’y
glissaient, et les vieilles chaussures du garçon
devenaient leur maison.
Depuis toujours, il
croyait que son rôle était d’aider le vivant sans langage,
celui qui ne pouvait articuler sa souffrance. Il était
devenu un jardinier remarquable grâce à une qualité
d’observation et une compréhension de la terre peu
communes. L’hypersensibilité de Louis nourrissait son
intelligence du monde et, derrière ses airs taciturnes,
son cerveau foisonnait d’intuitions et de rêveries. Mais
jamais il n’aurait imaginé accueillir un jour un chaton
sans pouvoir veiller sur sa vie. Cette fois, l’incendie
brûlait en lui, tandis qu’au-dehors, la catastrophe
insistait.
Louis
finit
par s’assoupir sans trop savoir comment. L’aube venue,
il cligna des paupières. Il s’aperçut que son énorme
carcasse n’avait pas bougé de la chaise. Il y était
demeuré assis, le torse replié vers les genoux,
formant
ainsi
une cavité douillette pour le chaton, lequel ronronnait
encore… Il se redressa. La petite bestiole s’éveilla à
son tour et, d’un mouvement gracile, vint chercher du
museau la main de son maître. « Bonjour »,
pensa Louis, sans que les mots franchissent ses lèvres.
Les deux compagnons se
séparèrent enfin. L’homme se leva et le chaton bondit à
terre. D’un même pas, ils s’approchèrent de la fenêtre
baignée d’un arrogant soleil. Vu de dos et à contre-jour,
le contraste de leurs silhouettes était saisissant. À
gauche, un géant : cou de taureau, épaules massives
d’où coulaient d’énormes bras flanquant une large cage
thoracique et des hanches replètes, portées par des jambes
si épaisses qu’on les aurait dites moulées dans du
mortier. À droite, un minuscule bout de queue tout hérissé
se faufilait, surmontant un arrière-train fluet et poilu.
De part et d’autre de la petite tête jaillissaient des
moustaches comme les gerbes d’une fontaine et, à son
sommet, pivotait une paire d’oreilles à la pointe
légèrement arrondie. Elles étaient si fines qu’elles
semblaient découpées dans du papier.
Le duo entendit des cris
à l’extérieur. Une voix masculine, pétrie d’accent slave,
une autre, féminine, s’entremêlaient en une boucle de
« Oh là là ! », « Pas
possible ! », « Bon sang de bon
Dieu ! » – autant d’exclamations dont la
forme policée dissimulait une envie de jurer plus
grossièrement. Louis finit par apercevoir les auteurs de
ce lamento : c’était le couple de voisins qui venait
d’investir la grande maison de l’autre côté de la route.
Ils arpentaient leur propriété, dévastée pendant la
nuit. Lui, agile octogénaire, s’agitait en tous sens,
ramassait une à une les branches éparpillées, les
examinait avec l’air désarmé d’un rescapé. Elle,
vraisemblablement plus jeune, s’était juchée sur le tronc
d’un pin couché au sol. Pointant du doigt le terrain
raviné – où la boue avait déjà séché sous l’effet du
jour naissant –, elle lança d’un ton théâtral les
mots de Federico García Lorca : « Revoici le
soleil. Le jardin saigne, jaune. »
Le chat miaula. Louis s’accroupit, l’attrapa, le
serra. L’image d’un « jardin qui saigne » lui
fit pleinement réaliser l’horreur des dégâts qui
s’étalaient sous son regard. La nature s’apparentait à ces
survivants d’un naufrage qui ont encore au fond de la
pupille des traces d’épouvante et des poussières de folie.
Les arbres, les pauvres arbres avaient souffert et leur
bois brisé avait libéré des odeurs qui s’amalgamaient dans
l’air matinal : l’éclat mentholé de l’eucalyptus, la
fraîcheur acide des citronniers, le flot doux et mielleux
du tilleul, la note résineuse des ifs flamboyants… Les
prairies s’étaient retournées sur elles-mêmes, l’herbe
métamorphosée en une incommensurable motte brune..."