Gökotta
photographique autour
de la loge n°5
Courvières
(Haut-Doubs), loge n°5
début juin 2025 - fin du
printemps

Au lever du jour...
Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025


6h35
Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025
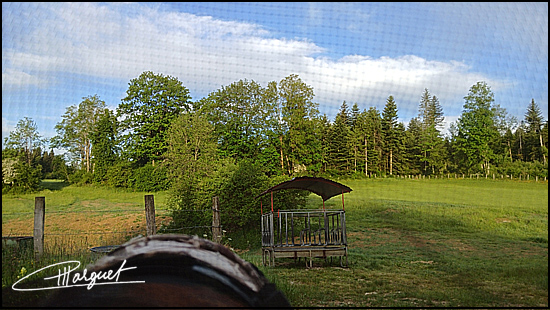

Mésange charbonnière
Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025




Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025


Géranium colombin
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai
2025


Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025
<image recadrée>

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025



Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025


Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai 2025





Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 31 mai
2025

Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 1er juin 2025

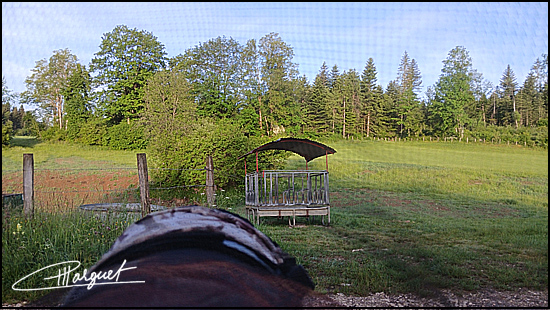
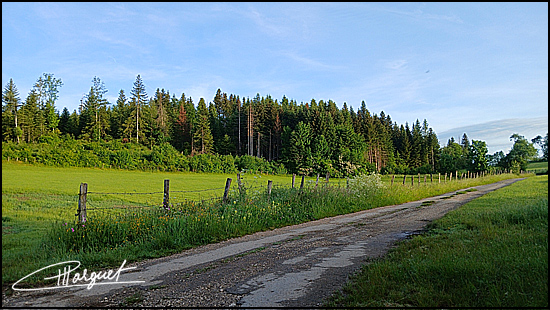
6h39
Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 1er juin 2025

Rosée et
Alchémille
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 1er
juin 2025


Courvières (Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 1er juin 2025






Géranium colombin
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 1er
juin 2025




Rosée et
Marguerite
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 1er
juin 2025


Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 1er
juin 2025

Au lever du
jour...
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025


Il pleut !
La chevrette est au bon de l'affût...
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025

9h00
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025
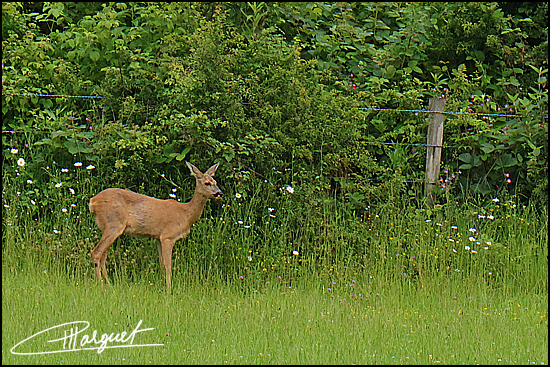
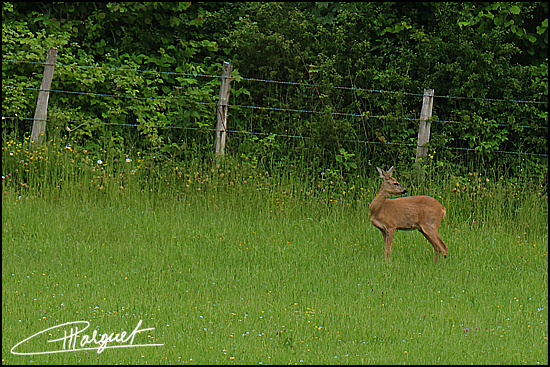
Chevrette sous la
pluie
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025



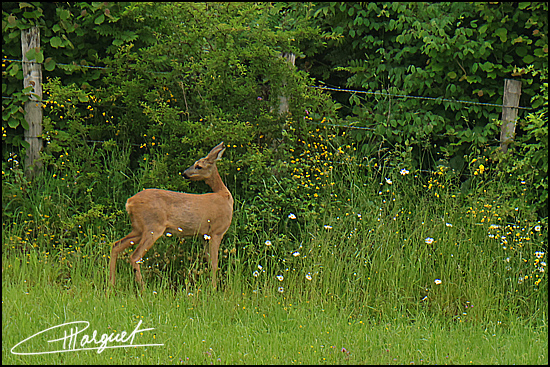


Couchée
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025


Après la pluie
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025


Gesse de Bauhin
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025

Cercope sanguin
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025


Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 8 juin
2025

Au lever du
jour...
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025


6h29
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025


Bergeronnette grise adulte
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025

Rougequeue noir
femelle
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025



Punaise arlequin
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025



Moro-Sphinx (flou
!) butinant
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025


Salsifis en fruit
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025


Gesse de Bauhin
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025


Benoite des villes
(commune) - Geum urbanum
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025

Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
samedi 14 juin
2025

Au lever du
jour...
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 15
juin 2025

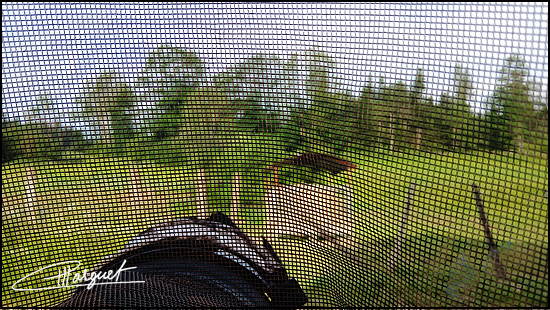

7h26
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 15
juin 2025


Bergeronnette
grise adulte
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 15
juin 2025


Toilette
Courvières
(Haut-Doubs), loge n° 5
dimanche 15
juin 2025





dimanche 15 juin 2025